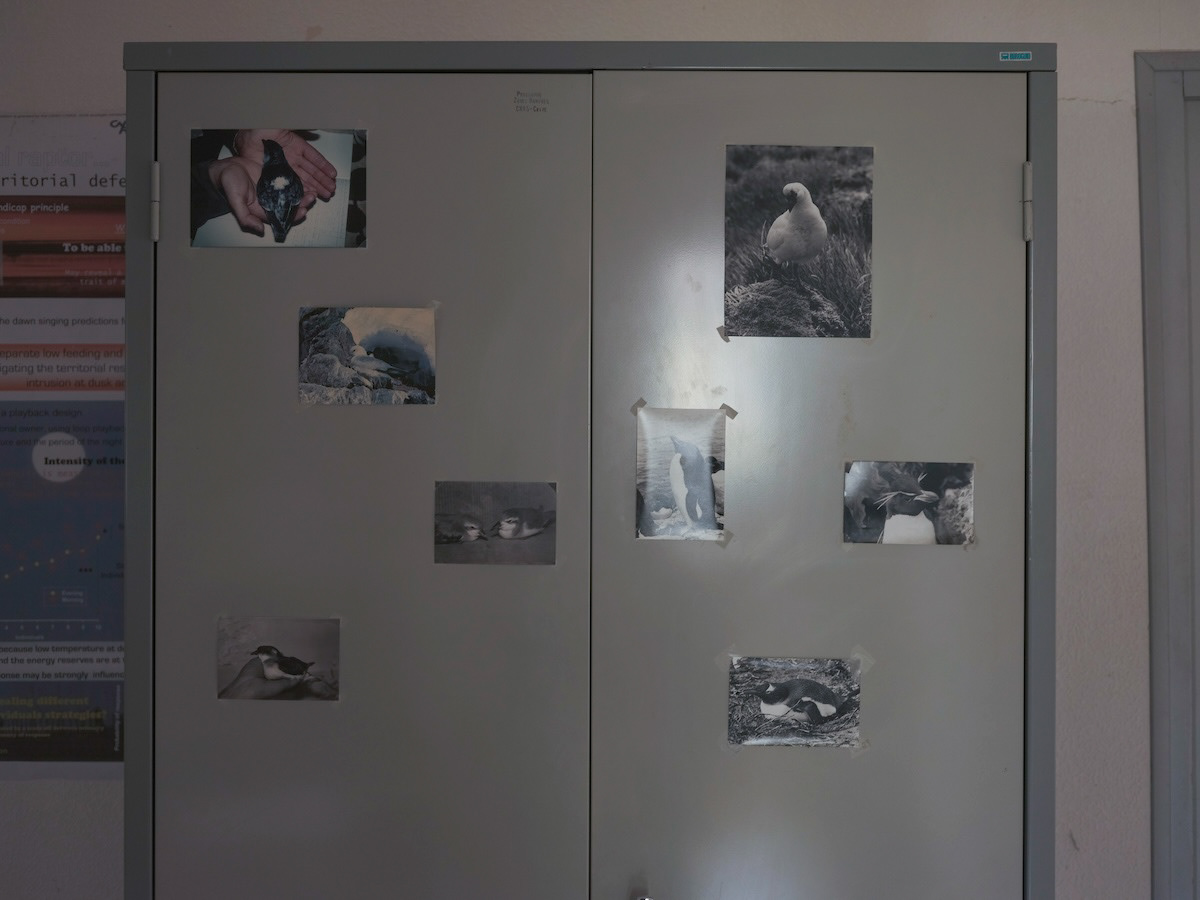Histoire ancienne
À la fin de la préhistoire, une chênaie-hêtraie s’étendait probablement des rives sud du golfe des Pictons, englobant la forêt de Benon jusqu’en Angoumois dans les forêts de Boixe et de la Braconne, de part et d’autre de la vallée de la Charente. Ses dimensions exactes sont méconnues à ce jour. L’ensemble forestier appelé forêt d’Argenson au 11e siècle (Sylva de Arieshum), et englobant les actuelles forêts de Tusson, d’Aulnay, de Chizé et de Benon, formait la limite entre deux peuples de la Gaule celtique, les Pictons et les Santons, qui ont par ailleurs contribué au premier défrichage de ce massif forestier.
En -56, les légions romaines conquièrent l’Aquitaine, et romanisent cette province qui devient alors impériale pour 3 siècles et demi. La forêt recule avec la culture de la vigne et l’établissement de villas gallo-romaines. Si l’emplacement des villas n’est connu qu’en partie, les toponymes possédant le suffixe -acum, devenu -é ou -y, marquent ces domaines gallo-romains : Marigny (Mariniacum), Prahecq (Paratus-acum), Périgné (Payrigniacum), Secondigné (Secundinius-acum), Séligné (Silaniacum), Chizé (Chisiacum), Aulnay (Aunedonacum), Nuaillé (Novalis-acum), etc. Mais ce sont surtout les nouvelles voies romaines qui vont démembrer le massif forestier : la voie de Poitiers à Saintes a séparé la forêt d’Aulnay, d’un côté, de l’ensemble boisé constitué aujourd’hui par la forêt de Chizé et les bois d’Availles et de Villedieu, tandis qu’une seconde voie allant de Niort à Saintes a permis le défrichement entre la Forêt de Chizé et celle de Benon. Par le traité de 418 avec l’Empire romain, les Wisigoths obtiennent l’administration d’une vaste province englobant Poitiers et Saintes, et s’en suit rapidement l’invasion arabe. Ces deux épisodes historiques ne semblent pas avoir eu d’influence notoire sur la forêt, hormis le lent défrichage opéré par les populations locales en temps de paix.
Durant le haut Moyen Âge carolingien, Chizé, son gué sur la rivière Boutonne et sa forêt dépendant du vaste pagus de Brioux, et la forêt devient une sylva communis. Dans le cartulaire De villis et curtis, datant du premier tiers du 9e siècle, on relève l’article suivant : Que nos bois et nos forêts soient surveillés ; qu’ils [nos intendants] fassent défricher les endroits qui doivent l’être, mais qu’ils ne permettent pas aux champs de s’accroître aux dépens du bois ; où les bois doivent être, qu’ils ne permettent pas de les couper ou de les endommager ; qu’ils veillent bien dans nos forêts sur le gibier, qu’ils entretiennent à notre usage des ciseleurs et des éperviers, et qu’ils lèvent diligemment les redevances pour ces biens.
Tandis que le bourg de Chizé se développe à partir d’un lieu fortifié, pour surveiller le gué sur la rivière Boutonne, la forêt devient une réserve de chasse pour aristocrates. Guillaume VII fonde l’aumônerie de Saint-Gilles de Surgères, et lui donne momentanément tout droit d’usage de la forêt de Chizé, mais le passage du Poitou aux Plantagenêts voit très vite la cessation de cette concession, Aliénor d’Aquitaine puis Richard Cœur de Lion accordant un droit d’usage de la forêt pour le bois de chauffage, de construction et d’outillage, ainsi que des droits de pâturage et de panage au prieuré des Hermitans (dépendant de l’abbaye de Fontevrault) et à l’aumônerie Saint-Jacques de Chizé. La forêt reste néanmoins un lieu de chasse comme pour Richard Cœur de Lion.
Des villes neuves sont créées en périphérie de la forêt avec la poussée démographique qui marque la fin du 12e siècle et le début du 13e ; elles sont souvent dues à l’arrivée de population venue pour défricher. Les villes neuves sont fondées au sud-ouest de la forêt de Chizé, le long de la route reliant Niort et Saint-Jean-d’Angély : Belleville, La Cigogne, Boisserolles, Villeneuve, Villenouvelle, La Croix-Comtesse, etc., avec des chartes aux privilèges importants, dont l’usage de la forêt pour le bois sec pour se chauffer et les arbres nécessaires à leur usage ; mais aussi la chasse aux lièvres et aux loups. Pour Villeneuve par exemple, la charte des droits d’usage indique que tous les habitants de la ville auront leur plein usage dans la forêt à l’exception de trois types d’arbres : le chêne, le hêtre et le frêne. Mais toutes les essences peuvent être prélevées pour construire une nouvelle maison à condition de se le faire délivrer par les forestiers, dans une logique colonisatrice explicite. Malgré le retour dans la couronne de France et les changements institutionnels engagés, les défrichements monastiques semblent peu importants à Chizé. Les déboisements effectués par les moines de l’abbaye augustinienne de Saint-Séverin et ceux des prieurés relevant de l’abbaye bénédictine Saint-Jean-de-Montierneuf se firent sur la lisière méridionale de la forêt, entre Saint-Séverin et Le Vert (La Vallée du champ de l’Abbaye ainsi nommée), et des défrichements de la plaine d’Augé au sud-ouest, dont la création de la vaste clairière de Villiers-en-Bois. Plus spectaculaires sont les défrichements des villes nouvelles avec la création de la clairière de Villenouvelle au sud-ouest de la forêt. Les autres clairières à l’intérieur de la forêt possèdent-elles aussi des noms médiévaux qui ne fait aucun doute sur leur origine : les Essarts, les Alleuds, la plaine de la Raye, et il en va de même pour les hameaux : Montifaut, Carville, Petit-Villeneuve, etc.
La forêt semble inépuisable, mais elle subit des dégradations telles qu’Alphonse de Poitiers, frère du roi Saint Louis, prit des dispositions pour la sauvegarder en établissant le Censif du domaine de Chizé vers 1247-1248 : le droit de pâturage est réduit et exclu de 4 défens : les deux parcs de Chizé et de Villiers, le Bois plain (dit aussi le Fief aux Forestiers) et la forêt des Essarleron. La région de Chizé fut ensuite très affectée par la Guerre de 100 ans, avec une régression démographique et un repli de l’espace rural. Des parcelles cultivées sont abandonnées, s’ensauvagèrent pour être reprises par la forêt.
Au 15e siècle, Charles d’Angoulême, seigneur de Chizé, promulguait une ordonnance forestière en 20 articles datée de 1491, résultat de la compilation des coutumes, divers ordonnances et statuts préexistants. Pourtant, cela n’enraye en rien le déclin de la forêt. Il faut attendre l’action de François 1er, dit le Père des veneurs, et son ordonnance de 1516 interdisant la chasse dans les forêts, buissons et garennes royales ainsi que le défrichement. Une réformation est menée en forêt de Chizé à partir de 1553, sous la direction de Dreux du Vivier, commis par le roi Henri II, pour réformer les eaux et forêts du Comté de Poitou. Mais durant les Guerres de Religion, la ville de Chizé est assiégée et prise par les huguenots, et la forêt pâtit du pillage des paysans ruinés, lorsqu’il ne s’agit pas de coupe de bois opérée pour les réparations de la ville ou du château de Niort. Plus tard, Colbert ordonne la grande réformation des forêts royales, mais Chizé n’offre pas un bois de qualité suffisante pour la Marine, et la forêt fait l’objet d’une orientation minimum : entourer la forêt de fossés, ne laisser que trois grands chemins (le chemin de Chizé à Saint-Etienne-la-Cigogne, celui de Chizé à Beauvoir et celui de Marigny à Saint-Séverin), recépage des parcelles abîmées, coupes et ventes ordinaires pour obtenir du haut taillis à 20 ans, sans laisser les arbres de futaie vieillir au-delà de 60-80 ans. Sa surface de 8 180 arpents fut délimitée par 798 bornes et séparée de la forêt d’Étampes par 32 autres bornes. Cette réforme forestière est un échec, un de plus, et le commerce illicite de bois prospère vers Niort. La carte des Cassini présente la forêt de Chizé défrichée avec ses vastes clairières centrales et de petits domaines engagés au cours du 18e siècle le long de ses lisières. La forêt est alors exploitée pour ses chênes de faible qualité de charpente et ses hêtres, cette dernière essence étant rare dans la région et facile à travailler pour les objets manufacturés.
À la fin du Premier Empire, la concession des Minimes de La Rochelle et la forêt d’Étampes furent réintégrées à la forêt nationale de Chizé. En 1831, le propriétaire de la portion restée non domaniale obtint l’autorisation de défricher 80 hectares ; il le fit d’une façon quasi géométrique en créant la métairie de Terre-Neuve. La situation sylvicole de la forêt de Chizé ne cesse de se dégrader dans les années 1870 avec le dépérissement du hêtre, dû à une période de sécheresse. En 1888, un projet d’aménagement vise à convertir en taillis sous futaie toute la forêt pour produire du chêne alors même que les capacités de cette forêt sont limitées du fait du calcaire effleurant qui induit une mauvaise croissance des arbres achetés comme bois de feu, et non comme bois d’œuvre. Ce réaménagement est un échec patent et un nouveau projet sylvicole voit le jour en 1920 : reconstituer une futaie mélangeant chênes, charmes et hêtres pour donner un couvert suffisamment épais afin de provoquer la formation d’un humus durable. Une fois encore, la Seconde Guerre mondiale apporte son lot de perturbations par une exploitation accrue de certaines parcelles, ce qui fut néfaste pour l’avenir des sols, comme en 1888, ainsi que des coupes exceptionnelles pour produire des traverses de chemin de fer.
Les sols de la forêt, dont la faible épaisseur d’humus a été compensée par le fractionnement de la roche séquanienne, favorisent la croissance du hêtre et sa régénération naturelle. Mais, ces mêmes types de sols deviennent brûlants (pour reprendre le terme forestier) lorsqu’ils sont découverts, et propices au développement du chêne pubescent et à l’érable de Montpellier, un peuplement dégradé d’origine subméditerranéenne. Les transformations du climat, les défrichements et dévastations des hommes ont fait de cette hêtraie une relique, comme l’indique Hubert Badeau, vestige d’une forêt préhistorique. Elle a été fortement touchée par la tempête Martin (hiver 1999) qui a couché au sol de nombreux grands hêtres. Ce massif a enfin été coupé en deux par la route départementale 950, construite en grande partie sur l’antique voie gallo-romaine, finissant le morcellement paysager du massif forestier.